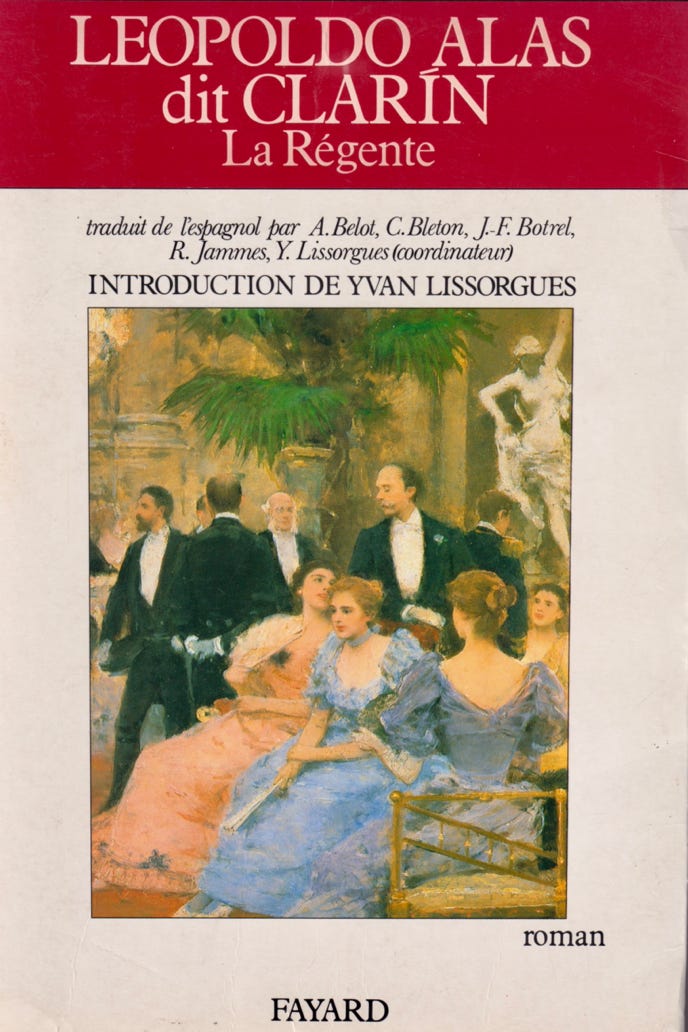LEOPOLDO ALAS CLARÍN, LA RÉGENTE ET L’ÉVÊQUE,
par Yvan Lissorgues et Jean-François Botrel.
A David Ruiz, in memoriam.
Son chapeau melon habituel enfoncé jusqu’aux yeux, le bas du visage enveloppé d’un grand châle que son attentionnée Onofrina lui a enroulée autour du cou, le Professeur Leopoldo Alas, avance à petits pas le long de la rue Uría couverte d’une épaisse couche de glace. Par précaution, il a pris la canne, la canne de son pauvre père disparu en novembre, il y a seulement trois mois, après une maladie qui l’a terrassé peu de temps après son élection à la mairie d’Oviedo et l’a empêché d’assumer la charge. Il avance prudemment, assure son pas sur ce sol glissant et son cœur se serre à la pensée de ce malheur qui s’est abattu sur la famille. Sa peine est forte et plus encore quand il pense à sa mère, seule maintenant dans sa maison de la rue Puerta Nueva Alta. Après son cours de Droit Romain, vers les trois heures, il passera la voir, comme chaque jour, pour apporter un peu de réconfort à cette bonne chrétienne, cette mère exemplaire. Et des images passent dans sa tête, Zamora où le hasard voulut qu’il naquît, Guadalajara, León et sa belle cathédrale…, d’autres capitales de province où Genaro Alas, son père, nommé gouverneur provincial par son mentor, le politique libéral Posada Herrera, amenait la famille. Plusieurs de ses contes et nouvelles ont pour paysage de fond, l’une ou l’autre de ces images, gravées depuis l’enfance. Souvenirs d’enfance ! La Messe de Minuit, par exemple, quel charme elle avait pour le jeune garçon qu’il était à l’époque, à l’époque où officiait à Oviedo son bon évêque don Benito Sanz y Forés qui avait éveillé en lui une sensibilité religieuse basée sur la foi en Jésus et les paroles de l’Évangile… Il y a quelques jours, le 25 décembre à minuit, il avait suivi la célébration de la venue au monde de Jésus dans la ferveur de sa tristesse, entouré de sa mère, doña Leocadia, toujours dans sa peine, de sa chère Onofre et de son tout jeune fils Leopoldo, Polín, un bambin d’un peu plus d’un an. Au cours de la messe, il s’était laissé envahir par le souvenir de son père au milieu de la joie bruyante et débordante de la foule des fidèles, pas du tout en accord avec la solennité du moment. Le nouvel évêque, Fray (Frère) Ramón Martínez Vigil, récemment nommé à la suite d’intrigues du cacique de Villaviciosa, Alejandro Pidal, qui, à la tête de la Unión Católica, avait fait allégeance à Cánovas, premier ministre conservateur, présidait la cérémonie. Alejandro Pidal, en récompense de son ralliement, avait été nommé Ministre de Fomento, un énorme ministère chargé de l’agriculture, de l’industrie, de l’ordre public et de… l’Instruction publique. Pidal était donc son ministre de tutelle… qui n’avait rien de tutélaire ! En tout cas, ces catholiques opportunistes, Pidal en tête, de la Unión Católica étaient méprisés, appelés mestizos, métis, par ceux qui n’acceptaient pas la compromission avec le régime, les carlistes en particulier… Et il était là, au pied de l’autel, cet évêque affublé de tous ses rutilants attributs, sa mitre, sa crosse, sa chasuble d’or et rien, dans cette ambiance de fête ne rappelait que Jésus était né dans une pauvre étable, entouré de ses parents Marie et Joseph, réchauffé par le souffle de la vache et de l’âne. Lui, depuis son adolescence, il avait pris conscience que ces rites ancestraux organisés par l’Église catholique fossilisaient la sensibilité religieuse du peuple en la limitant à des postures mécaniques, loin des élans du cœur. Lui revenait aussi en mémoire ces nuits et ces jours de Noël qu’il avait vécus dans sa fougueuse jeunesse madrilène et surgissaient des bribes de ce qu’il en avait écrit dans les journaux d’opposition à la monarchie restaurée, El Solfeo et La Unión… « La naissance de Jésus n’a rien à voir avec cet infernal fracas que le bon peuple de Madrid répand avec fureur dans les rues, les places et les tavernes » …
« Si un chrétien des premiers siècles, un de ces chrétiens qui prenaient le christianisme au sérieux et le payaient de leur peau, que dirait-il en nous voyant déambuler si joyeusement agités dans la rue de San Jerónimo ! » … « Pour être chrétiens comme ces dames et ces messieurs, il n’était pas nécessaire que Jésus-Christ vienne au monde, pour ces gens, Jupiter tonnant était bien suffisant » … Il s’en prenait alors dans la presse à cette Église catholique qui, en organisant ces célébrations populaires de fêtes religieuses, n’hésitait pas à « paganiser les âmes ». Et pire, que dire de la célébration de la Résurrection dans … les arènes ! « Peut-on appeler chrétien un peuple qui fête la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ en voyant mourir dans l’arène plusieurs quadrupèdes et parfois un ou deux bipèdes ?». Tous ces souvenirs et toutes ces faits observés lui trottaient dans la tête et il savait que tout cela prendrait forme accomplie quand, dans la rédaction du deuxième tome de La Regenta, il décrirait la nuit de Noël et la Messe de Minuit dans la cathédrale de Vetusta. Il avait même déjà prévu d’y faire intervenir, sous forme d’une formidable ironie, l’athée officiel, Pompeyo Guimarán, de l’héroïque cité de Vetusta. Oui, il avait choisi La Regenta comme titre de son roman et non Vetusta comme il avait pensé au début, pour indiquer qu’il donnait la primauté artistique à la captation de la complexité psychologique de la protagoniste, Ana Ozores, sur l’impulsion première de la peinture satirique des mœurs de la vieille cité.
Toutes ces réflexions lui chauffent l’esprit, mais pas les mains qu’il sent gelées sous les moufles.
Il fait très froid ce matin. Cet hiver de 1884 est un des plus rudes de ces dernières années, disent les gens. Les toits, festonnés de stalactites de glace, sont couverts d’une épaisse couche de neige et au loin le Mont Morcín se découpe tout blanc sur un ciel bleu acier. Il est sorti plus tôt que d’habitude pour se rendre à l’Université où l’attendent ses vingt-neuf étudiants, car il veut passer avant à la librairie de son ami Martínez pour savoir s’il y a du nouveau au sujet du premier tome de La Regenta, dont le manuscrit a été envoyé fin octobre à l’éditeur Daniel Cortezo directeur de la Biblioteca Arte y Letras de Barcelone. Tout au long de ces derniers mois, il a reçu des épreuves, revues par le grand critique catalan José Yxart et les a renvoyées corrigées aussi vite que possible. Il sait que l’ouvrage est prêt, il l’attend depuis fin décembre et il n’arrive toujours pas. Il a hâte de voir ce livre encore inconnu dans sa forme définitive, hâte de découvrir ces illustrations annoncées de Juan Llimona, artiste peintre et illustrateur connu, hâte de caresser de la main et des yeux ce premier tome de son roman qu’il a vécu si intensément pendant des jours et des nuits. Il est dans la rédaction du deuxième. Malgré le petit pincement d’angoisse devant les méandres inconnus de la création, il sait où il va, le plan est minutieusement établi, la suite est dans sa tête en permanente effervescence, il sait déjà, comme il l’a écrit sur un feuillet, que le dernier mot avant le point final sera « crapaud », « le ventre froid et visqueux d’un crapaud ».
Voici enfin la Librairie Martínez, plaza de Riego, sa plaque tournante culturelle ! C’est ce bon Monsieur Juan Martínez qui se charge d’envoyer ses articles aux grands journaux de Madrid ou de Barcelone, La Publicidad, Gil Blas, El Progreso, El Día, La Ilustración Española y Americana, El Imparcial, et les autres… ; enfin, c’était avant, maintenant il ne lui reste que Madrid Cómico et La Ilustración Española y Americana, tous les autres ont mis fin à sa collaboration. Des cinq ou six articles par semaine qu’il remettait à Martínez en passant chemin de l’Université, il ne dépose que les « Paliques » pour Madrid Cómico et quelques articles plus sérieux pour La Ilustración Española y Americana. Il regrette cet étiage journalistique, mais il n’en souffre pas trop, car ses nuits et une grande partie de ses jours sont occupés par l’écriture fébrile de sa Regenta. Il a écrit ces derniers mois jusqu’à l’épuisement. Il se souvient que cet été dans son refuge campagnard de Guimarán, il écrivait à son ami Galdós « Ma santé est bien chancelante, maux de tête, perte de la vue, aphasie et autres troubles délicieux ».
Martínez se charge aussi des commandes de livres à Paris. Balzac, Flaubert, Zola, tous ces ouvrages lus qui s’empilent dans son bureau lui sont ainsi arrivés. Pot-Bouille qu’il vient de recevoir, moins de trois semaines après la commande ! Quel progrès, tout de même !
Et sa Regenta qu’il est si impatient de voir et qui tarde tant à arriver ! D’après Martínez, toujours bien informé, les sacs du courrier dans lesquels se trouvent les paquets du roman sont dans un wagon immobilisé près du tunnel de Pajares, pas encore en service, ou en gare de Busdongo. La neige bloque le col et le chariot qui habituellement fait la liaison entre la gare de Busdongo et celle de Puente de los Fierros , de l’autre côté du col de Pajares, ne peut pas circuler. Encore quelques jours à attendre !
Ses journées et ses nuits sont toujours aussi remplies. A la rédaction des chapitres programmés de la deuxième partie de La Regenta, s’ajoute une reprise de l’activité journalistique. Si le propriétaire de El Día, le marquis de Riscal, qui ne veut plus entendre parler de naturalisme ni de Zola, a mis fin à sa collaboration, il est heureux d’être accueilli par El Globo, le journal de Castelar, ce républicain modéré et son récent ami et chef politique. Il est aussi invité à collaborer à La Ilustración Ibérica, à Madrid Político. C’est peut-être le signe d’une reconquête de la presse républicaine et libérale. Et puis, il lit, il lit les nouveaux romans de ses amis, Galdós, Palacio Valdés, Pereda, ceux de doña Emilia Pardo Bazán, ceux qui lui arrivent de Paris ; il s’intéresse aux nouveaux talents, Emilio Bobadilla et autres qui ne semblent pas très prometteurs. Il est attentif aux récentes publications de poésie, celles de Zorrilla, Campoamor, Núñez de Arce, de Manuel del Palacio et il suit avec avidité dans la presse les premières des pièces de théâtre, ce théâtre, celui d’Echegaray en particulier, qui a enthousiasmé ses années madrilènes, lui qui très jeune rêvait de devenir acteur…
Il se trouve bien à Oviedo, écrit-il a son ami Galdós, dans la chaleur des siens, dans sa petite maison lumineuse, avec vue sur la neige du Morcín ; le billard du Casino, à l’Université quelques étudiants intelligents. Ce n’est pas si mal.
Surtout, il aime enseigner. Son cours de Droit Romain est fort utile, mais pas exaltant, aussi à la moindre occasion, il extrapole, fait des comparaisons, trouve des références littéraires chez Cervantès, Calderón, Lope de Vega, chez Balzac, Stendhal, Flaubert, Goethe, etc. Outre l’enseignement du droit, il pense que son rôle de professeur est d’ouvrir l’esprit de ses étudiants, de les inciter à la lecture pour élever leur niveau culturel afin de développer leur esprit critique. Finalement, il a conscience de poursuivre dans l’enseignement, la haute mission qu’il s’est donnée comme journaliste, ouvrir l’esprit du lecteur, inciter à la réflexion personnelle, amorcer le goût de la lecture en proposant dans les journaux de bons feuilletons, mieux, en publiant des contes, afin que le lecteur soit incité à aller du journal au livre, plus précisément au roman. Élever le niveau culturel de la Nation, telle doit être la mission de tout homme qui a le privilège d’avoir une certaine culture dans cette Espagne qui souffre d’un taux élevé d’analphabétisme.
A la maison, il passe les trois-quarts de son temps dans son bureau dont l’espace libre se réduit de semaine en semaine, rongé par les piles de livres qui s’accumulent. Depuis des années il réfléchit sur l’art du roman. Il a lu tout ce qu’il est possible de lire sur cette question, depuis les esthétiques de Hegel et de Krause, la poétique de Goethe, de Jean-Paul, de Baudelaire etc., les œuvres de Taine, de Lemaître, tous les écrits théoriques de Zola, la correspondance entre Flaubert et George Sand, les lettres des Goncourt. Il a lu presque toutes les œuvres de Stendhal, de Balzac, Dickens, Flaubert, Zola et bien sûr celles d’Alarcón, Galdós, Pereda, Palacio Valdés, etc. Tous ces livres sont là, en désordre, réduisant son espace vital. Sur sa table de travail, s’érigent des piles d’articles publiés dans la presse, dont certains sont de véritables essais, comme « Le naturalisme », « Du style dans le roman » et une infinité d’études critiques sur tous les romans dignes d’intérêt publiés en Espagne et hors d’Espagne.
Quand en fin d’après-midi il est assis à sa table de travail, souvent Polín se glisse par la porte entrouverte et se blottit sur ses genoux. Le bambin est fasciné par la tête majestueuse d’un vieillard, dont la photo est collée au mur : « Ce grand-père chevelu est Victor Hugo, le meilleur poète de tous les temps, comme tu l’apprendras bientôt, mon petit ».
Le soir ou à divers moments de la journée, il discute avec Onofre tandis qu’elle s’affaire dans ses tâches ménagères ou quand elle s’installe près de lui. Elle lit la plupart des romans espagnols qu’il reçoit et sur chacun elle lui dit ce qu’elle pense. Ils ont ainsi d’interminables discussions.
A propos de l’écriture de son roman, il explique à son épouse que lorsqu’il sent que la narration est bien mûre dans son esprit, elle sort d’un trait sur le papier sans trop d’hésitations pour le choix du mot juste. Quant au processus de création, il est assez clair pour lui que son imagination est fondamentalement alimentée par la réalité extérieure, la poétique réalité de l’espace et du paysage humain d’Oviedo, mais c’est une imagination chargée d’une réalité littéraire qui affine la perception, guide et amplifie la capacité analytique d’introspection de ses personnages et renforce l’aptitude empathique. Il est clair que son Ana Ozores est, comme fille de son imagination, la sœur de la malheureuse Isidora de La desheredada du grand Galdós et de la mince María de Marta y María de l’ami Armando. Mais il est convaincu, en toute modestie, que son Ana est la plus grande, la meilleure sœur de toutes par la grandeur qu’elle acquiert au cours de sa vie littéraire. Il pense qu’elle peut rivaliser avec l’Emma de Flaubert et même qu’elle lui est supérieure par la naturelle complexité de sa vie intérieure.
Au moment même où il approfondit la personnalité d’Ana et de Fermín de Pas, le Magistral de Vetusta, il lit El primo Basilio de Eça de Queiroz, qu’Onofre ne connait pas encore, et il découvre un frère créateur qui « intime » lui aussi avec Flaubert, Balzac, Zola. Il y a des relations entre tous ces romans, des imitations de tendances, de procédés, mais chacun a son intrinsèque originalité. La supériorité de Eça de Queiroz réside dans son aptitude à capter la vie intérieure de ses personnages, de Luisa surtout qui par la complexité de son caractère est une vraie sœur de son Ana.
Quand, après le dîner, il s’enferme dans son bureau, il ne prend pas la plume tout de suite. Prolongeant la discussion qu’il vient d’avoir avec son Onofrina, il pense, il réfléchit, il médite, car entretemps lui est revenu en mémoire l’expression interiores ahumados (intérieurs enfumés) dont parle Marcelino Menéndez Pelayo dans le remarquable prologue qu’il consacre aux Obras completas de Pereda. C’est un éloge sous la plume de Marcelino, mais il pense qu’il y a beaucoup à faire dans la captation et la peinture des intériorités. Quel que soit l’objet de la représentation, le romancier doit explorer le fond de toute chose, l’intérieur des foyers ; l’intérieur des classes sociales, des institutions et surtout l’intérieur de l’âme des personnages. Ce que ne font pas vraiment les romanciers d’aujourd’hui. Par exemple, dans les romans consacrés au grand monde, nous avons la duchesse (toutes les duchesses) la marquise (toutes les marquises) : aucune de ces femmes n’est profondément étudiée. Isidora, la protagoniste de La desheredada de Galdós, est la première femme réelle crée par Galdós, mais chez elle prédomine le générique, Isidora est le résultat de notre vie sociale, plus que le résultat de l’étude individuelle d’un caractère de femme.
C’est dans les demi-teintes, dans les tempéraments indécis, comme dit Hegel, que se trouve la masse commune de l’observation romanesque.
Pour être un « plongeur de l’âme », il faut savoir des choses enseignées par la science et savoir beaucoup de choses enseignées par la vie. Comme dit Taine, « les romanciers sont des collaborateurs de la science ». Oui, il est convaincu que pour ce qui est de l’étude de l’âme, la littérature peut aider la science et même lui être supérieure.
Il lui est agréable de voir que Galdós se rapproche chaque fois plus de la peinture de la complexité humaine, mais il décèle chez ce grand romancier une sorte de crainte de se perdre dans les intérieurs enfumés. Pour ce qui est du style du narrateur, c’est un progrès que l’auteur de La desheredada, et de Tormento commence à pratiquer le « style latent », c’est-à- dire l’indirect libre, le seul qui permette d’exprimer le langage intérieur du personnage. Lui, il l’a appris chez Flaubert et Zola, et c’est ce qui lui permet d’être en chaude empathie avec Ana, Fermín, le saint évêque Fortunato et même Paula, la rude mère de Fermín et aussi, sur le mode ironique, avec le pauvre Saturnino Bermúdez.
En définitive, il lui semble que l’art du roman est en Espagne sur le bon chemin qui le conduit vers la hauteur du temps, un roman qui peut rivaliser avec ceux de Flaubert, de Zola ou Tolstoï, qu’il découvre, émerveillé, un roman qui tout en conservant sa valeur artistique soit la représentation profonde et harmonieuse de la vie dans sa poétique complexité.
Enfin, le 7 janvier de cette année 1885, Martínez lui fait savoir que les paquets de livres sont arrivés à la librairie.
C’est un beau livre, bien qu’il eût préféré que la couverture soit plus sobre. Les illustrations de Llimona sont très suggestives et marquent opportunément les étapes du récit au point qu’elles constituent un résumé illustré de l’argument. Il lit attentivement son roman pour la première fois en lettres d’imprimerie. Mais quel désagrément ! Il relève cent-trente-sept errata sur l’ensemble de l’ouvrage. Intolérable ! Il a l’habitude de voir ses articles de presse truffés de coquilles, mais là il s’agit de sa première œuvre d’art et il est hautement préjudiciable de la voir enlaidie de la sorte. Il sait qu’il est certainement responsable de ce gâchis. Que de fois les typographes se sont plaints de ses illisibles gribouillis ! Tout de même ! Il faudra que le prochain tirage soit impeccable.
Le roman est en position bien visible à la vitrine de la librairie de Martínez et au bout de quelques jours celui-ci lui révèle que la vente a tardé à démarrer, mais que maintenant ça part comme des petits pains chauds. Il semble que le bouche à oreille fonctionne à plein et que le livre se répand avec frénésie dans les foyers bourgeois et aristocratiques de la ville et le libraire ajoute avec un sourire, « comme une traînée de poudre ».
Pour fêter l’événement et leur remettre un exemplaire, il invite ses collègues et amis, Félix de Aramburu, Adolfo Buylla, Adolfo Posada, Aniceto Sela, tous, comme lui, en relation plus ou moins étroite avec la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, cette école prestigieuse fondée par Francisco Giner de los Ríos, leur maître vénéré, sur les bases de la philosophie ouverte et progressiste de Frédéric Krause. Quand ils sont tous réunis dans le petit salon, il distribue à chacun un exemplaire préalablement dédicacé. Le livre est feuilleté, on s’arrête sur les illustrations, on les trouve bien, on s’extasie. L’auteur de ce beau livre est chaudement félicité et on lui promet une lecture attentive et rapide. Buylla, qui connaît des familles plus ou moins huppées de la ville, révèle que certains cherchent à mettre des noms de personnes de la ville sur tel ou tel personnages du roman. Lui, il se contente de sourire, ne dément pas mais n’ajoute rien.
La conversation tourne autour de ces gens de la haute bourgeoisie, de ces nobles riches ou ruinés, tous conservateurs et bigots et surtout de ces gens d’Église, depuis l’évêque pidalin, jusqu’au sacristain. Oui, Oviedo est une ville lévitique qui voit d’un mauvais œil toute nouveauté, toute idée moderne. Pas un germe de progrès dans ces beaux quartiers patinés par le temps. Ils regardent l’Université avec méfiance et eux, tous les cinq ici réunis, pour leurs relations avec des groupes pas très catholiques de Madrid, leurs prises de position progressistes et leurs aspirations républicaines, sont perçus par certains comme une menace. Lui, il pense à la peinture de Vetusta et des mœurs cléricales dévoilées dans son roman par le jeu de ses plaisantes et acerbes ironies et il se contente de répondre à ses amis par un sourire entendu.
Adolfo Buylla, dont la famille est bien implantée dans ce milieu de la haute bourgeoisie d’Oviedo, précise que ces gens ont été traumatisés, après 1868, par les six années d’agitation révolutionnaire qui ont débouché sur le vote de la constitution de 1869 qui stipulait la séparation de l’Église et de l’État et sur la proclamation de la Première République. Bien que tout cela ait été balayé en 1875 par la restauration de la monarchie et que l’ordre ait été assuré par la constitution de 1876, la crainte est restée gravée dans les consciences réactionnaires. Quant à l’institution catholique, violemment agressée, elle s’est sentie menacée comme jamais et l’intégrisme s’est renforcé au point de proclamer que le « libéralisme était un péché ».
Ici, à Oviedo, certains de ces personnages bien en place, plus cultivés que les autres mais non moins agressifs, ont lu des articles de Leopoldo publiés dans les journaux plus ou moins progressistes de Madrid. Clarín (clairon, ce pseudonyme bruyant qu’il s’est donné) ne cesse d’attaquer l’institution catholique vide de spiritualité, de dénoncer l’article 11 de la Constitution de 1876 qui instaure le catholicisme religion de l’État. Clarín est pour eux une sorte de croquemitaine et du coup c’est tout notre groupe, que l’on sait uni par des valeurs affirmées, qui est en ligne de mire. On nous appelle le Groupe institutioniste d’Oviedo et nous en sommes fiers. Ils savent que nous n’acceptons pas ce triste et à la fois burlesque jeu politique du «tour » qui fait alterner au pouvoir les conservateurs de Cánovas et les libéraux de Sagasta, ils voient que nous dénonçons, souvent par la dérision, ce détournement de la démocratie qu’est le caciquisme qui a implanté dans chaque ville et village un cacique conservateur et un cacique libéral, chargés, à tour de rôle, d’organiser les élections à coups de prébendes, de distributions de privilèges et autres moyens de corruption, afin de fournir une majorité au premier ministre nommé par le roi Alphonse XII, soit Sagasta, soit Cánovas. Oui, dit Buylla, notre groupe est tenu pour dissident et c’est pourquoi, le cacique de Villaviciosa, Alejandro Pidal, maintenant ministre de Fomento, favorise la nomination à l’université d’Oviedo de nouveaux professeurs à sa botte, à la botte des mestizos et de leur parti, La Unión Católica, avec leur journal du même nom.
De fil en aiguille, ressort dans la conversation le grave conflit universitaire de cet automne ouvert autour du cas Morayta et significatif de l’emprise sur l’Université des forces réactionnaire.
Adolfo Posada rappelle que le premier octobre de l’an passé, Miguel Morayta, professeur de l’Université de Madrid, républicain et franc-maçon notoire, a été chargé du discours d’ouverture de la rentrée universitaire. Morayta est un ancien élève de Sanz del Río, le célèbre introducteur de la philosophie de Frédéric Krause en Espagne dont ils sont tous les cinq plus ou moins imprégnés grâce aux leçons de leur vénéré maître Francisco Giner. Le discours de Morayta a pour thème l’Égypte ancienne et la culture pharaonique et à la fin l’orateur évoque la liberté de parole du professeur d’Université, estimant que cette liberté est une condition fondamentale du progrès scientifique. Dans l’immédiat, il ne se passe rien. Le ministre de Fomento, Alejandro Pidal, félicite le professeur et se charge même de faire distribuer des copies du discours aux meilleurs étudiants.
La polémique éclate peu de temps après avec une rare violence, dans les journaux catholiques, La Unión Católica, organe de Pidal, El Siglo Futuro, carliste, qui demandent des sanctions contre Morayta. Les évêques sautent dans l’arène, brandissant de violentes pastorales. A l’Université de Madrid des étudiants conservateurs qui exigent la destitution du professeur s’en prennent à coups de poing aux étudiants libéraux. La force publique intervient, sabre au clair, pour rétablir l’ordre. Les troubles se prolongent durant les mois d’octobre et de novembre et se propagent dans les universités de province.
A Oviedo aussi les étudiants se soulèvent. Il faut rappeler que les enseignants qui doivent leur poste à Pidal, profitent de l’occasion pour, en sous-main, éliminer le recteur León Salmeán, respecté et apprécié par la majorité des professeurs et faire nommer par le ministre Pidal, Rodríguez Aranga, un intrigant, sans valeur scientifique et qui plus est de douteuse moralité.
Il est déjà tard, mais ces conversations sont bénéfiques, elles mettent de la chaleur dans la cohésion du groupe. Un silence s’impose. Leopoldo en profite pour se remémorer la fête de Santa Catalina, patronne de l’Université d’Oviedo, célébrée le 25 novembre, car il a toujours été intéressé en tant que citoyen et romancier par les mœurs cléricales. Cette fois ce fut le nouvel évêque, le dominicain Martínez Vigil, qui dans la chapelle de l’Université, monta en chaire pour « sermonner » cette « évolution de l’esprit humain qui commence par l’hérésie et finit par la négation absolue, en passant par le déisme, le panthéisme, et le matérialisme ». Il se souvient aussi que pendant que l’évêque parlait, des étudiants criaient à l’extérieur « A bas le ministre Pidal ».
Les semaines suivantes, quand il n’est pas absorbé par l’écriture, il est préoccupé de savoir ce que l’on dit de La Regenta. Chaque soir dans le cabinet de lecture du Casino ou dans la librairie de Martínez, il feuillette les journaux qui viennent d’arriver de Madrid. Parfois, sortent des entrefilets ou de courts articles qu’il juge trop convenus, trop superficiels, toujours décevants et bien qu’élogieux, peu convaincants car non justifiés. Il voudrait surtout savoir ce que pensent de son roman ses amis écrivains, Galdós, Pereda, Armando Palacio, Emilia Pardo Bazán, Marcelino Menéndez Pelayo, Picón, Francisco Giner … auxquels il s’est empressé d’envoyer un exemplaire.
Les lettres qu’il reçoit de ces derniers sont toutes élogieuses. Bien sûr, Pereda et Marcelino Menéndez Pelayo, fervents catholiques, ne manquent pas de critiquer la vision qu’il donne du monde clérical de Vetusta, et Pereda ajoute qu’il y a trop de « détails crus et obscènes », mais, à part cela, ils ne cachent pas leur admiration pour ses qualités d’observation des mœurs, pour son aptitude à capter l’intériorité de certains personnages et surtout pour l’agilité et la force de son style. Son ami d’enfance Armando Palacio Valdés, dont les romans ont beaucoup de succès, ne semble pas comprendre que l’on puisse donner dans un roman une telle dimension à l’analyse psychologique. Cela ne le surprend pas ; dans les études critiques des romans de celui-ci il a souvent reproché à son ami de ne pas suffisamment creuser la vie intérieure des personnages. Il pense que si Armando en reste là, il ne sera jamais un grand romancier, malgré le succès actuel de ses œuvres. La lettre de Galdós arrive le 24 février, « Depuis que j’ai commencé à lire votre roman, les personnages m’accompagnent […]. Si je rêvais (mais je ne rêve jamais), c’est d’eux que je rêverais ». Il est ravi que son roman soit aussi captivant et il répond à celui qui à ses yeux est le plus grand romancier de cette fin de siècle : « Le fait de se voir poursuivi (vous, Galdós !) par les personnages et les événements de La Regenta pourrait suffire à faire tourner définitivement la tête d’un romancier débutant ». Cependant, cette impression de son ami admiré n’est pas un jugement et le romancier débutant, n’est pas entièrement rassuré, car il se demande s’il a vraiment l’étoffe d’un romancier, s’il ne perd pas son temps à écrire des livres d’imagination. En fin de compte, il est déçu : « Si ce que m’ont écrit en courrier privé Galdós, Castelar, Pereda, Emilia Pardo, Echegaray, Menéndez Pelayo, avait été publié dans la presse, quel grand succès ! ».
Il écrit. Après ce petit repos qu’il s’est accordé pour apprécier les réactions des lecteurs du premier tome, il a bien vite retrouvé son rythme d’écriture. Que de nuits activées par les mots qui donnent vie à ses personnages : Ana, Fermín, Petra, Obdulia, Visita et tous les autres ! Comme l’an passé quand il rédigeait fiévreusement les chapitres de ce premier volume, ici maintenant sur un coin de la table, dès qu’il a couvert de sa nerveuse écriture un nombre suffisant de feuillets, il dépose, quand il se rend à son cours, la grosse enveloppe dans les mains de Martínez qui, selon l’habitude, se chargera de l’envoyer à Barcelone.
En cette fin d’avril, il sait que dans quelques jours il aura terminé cette grande œuvre de sa vie et il a hâte de savoir comment elle sera reçue…
Le 28 avril, alors qu’il vient de terminer son cours de Droit Romain, de déposer sa toge et son bonnet octogonal, et qu’il est sur le point de passer sa redingote et de mettre sur sa tête son chapeau melon, son ami Aramburu se précipite vers lui pour lui annoncer qu’on raconte en ville qu’il a distribué à chacun de ses étudiants un exemplaire de son roman. Et il ajoute que l’origine de la rumeur qui se répand dans les sacristies, les rues et les boutiques, serait un paragraphe ajouté à une pastorale, récemment publiée, de la plus haute autorité ecclésiastique de la province, l’évêque Fray Ramón Martínez Vigil. Il est stupéfait., mais c’est si gros ! Une telle calomnie, impensable !
Voici Adolfo Posada qui arrive, essoufflé, brandissant la fameuse pastorale et aussitôt il lit à haute voix la partie qui incrimine l’auteur de La Regenta et accuse de complicité les membres de l’institution universitaire :
Alors que la Constitution de la Monarchie déclare le catholicisme religion d’État ; et ne fait que tolérer —ce qui est déjà beaucoup— les opinions religieuses et l’exercice privé de leurs cultes respectifs, sauf le respect dû à la morale chrétienne, dans beaucoup de chaires de l’enseignement officiel, à la charge des contribuables catholiques, on fait fi de ces deux remparts que la Constitution oppose à l’erreur et on se livre à une propagande ouverte en faveur de l’athéisme et de la corruption. Il y a seulement quelques jours des élèves d’un cours de Droit ont reçu comme récompense et comme encouragement un livre saturé d’érotisme, de dérision aux pratiques chrétiennes et d’allusions injurieuses à des personnes particulièrement dignes de respect, sans que les autorités universitaires, ni les collègues appartenant au corps professoral —si pointilleux dans d’autres domaines— aient le moindre mot de protestation contre ce brutal agresseur de l’honneur d’honnêtes gens.
Sur le coup, il est médusé par la violence d’une telle attaque de la part d’un prélat qui brandit l’article 11 de la constitution de 1876 comme une menace. Ses collègues sont révulsés par les propos injurieux qui le visent. Être qualifié d’agresseur de l’honneur d’honnêtes gens ! Irrités par la dénonciation de tout le corps professoral qui serait complice et qui se voit traité avec un tel mépris. C’est intolérable et surtout incompréhensible. Lui, il confirme qu’il n’a jamais distribué à ses étudiants le moindre morceau de sa production littéraire, ni son roman ni ses contes et nouvelles, et d’ailleurs, il ne s’est jamais permis la moindre allusion à ses activités personnelles. Ou l’évêque a-t-il trouvé ce prétexte pour passer à l'attaque ? Manifestement, il a lu le roman et il n’a pas digéré la satire des mœurs cléricales qui y est faite, par ailleurs, il a dû prêter une oreille attentive aux propos de ceux qui ont essayé de deviner quelle était la personne qui avait servi de modèle à tel ou tel personnage. Athéisme, corruption, érotisme, dérision des pratiques chrétiennes, les accusations sont graves. Evidemment, étouffé par son courroux ce Monseigneur n’a rien vu d’autre dans le roman que cet aspect satirique et n’a pu formuler qu’un jugement idéologique. Bref, la brutalité même de cette sortie, laisse penser que l’évêque était à l’affût du moindre prétexte pour dénoncer cet auteur et son roman. Reste à savoir qui a pu raconter qu’il avait distribué ces livres aux étudiants. Comme lui et ses collègues savent que c’est une calomnie, il est clair qu’il va riposter et demander des comptes à cet impulsif et imprudent évêque.
Bien vite, il apprend la vérité quant à l’affaire de la distribution des livres aux étudiants de l’aveu même du responsable de la rumeur. Devant le scandale provoqué à l’Université par la pastorale, un étudiant de sa classe de Droit Romain finit par avouer que, surpris par son père, Monsieur Jovellanos, ultra-catholique bien connu, en train de lire La Regenta, il n’avait pas trouvé d’autre prétexte pour justifier cette lecture que d’affirmer que ce livre avait été distribué à tous les étudiants de la classe par le professeur, auteur du livre incriminé.
La question est grave, car s’il n’y avait pas de démenti, il pourrait être poursuivi, voire suspendu et en outre la vindicte du prélat s’étend à tous les membres de l’Université qui se voient accusés de complicité. Quelques jours plus tard, quand il rentre dans la salle où se tient l’assemblée des professeurs convoqués en urgence, il voit avec plaisir que tous ses collègues sont présents. Enfin, pas tous, les « sacristains gris », comme les appelle Posada, c’est-à-dire ceux, pas très nombreux, qui doivent leur poste à Pidal, se sont prudemment abstenus de se présenter ici. Même les bons catholiques déclarés sont présents et le groupe des carlistes est au grand complet. Matías Barrio y Mier et Guillermo Estrada qui ont eu d’importantes fonctions auprès du prétendant Don Carlos, affichent de petits sourires malicieux et lui font un léger signe de la main ; Víctor Díaz Ordóñez, sérieux, courtois, avec qui il est toujours heureux de débattre de questions religieuses, lui fait un petit signe de tête ; présent aussi un autre carliste, Justo Álvarez Amandi, qu’il connait moins. Il a de l’estime pour ces carlistes qu’il connait bien, ce sont des personnes droites, authentiques, bien que leur cause soit funeste pour la nation. Lui reviennent en un éclair les rudes batailles qu’il a menées dans sa jeunesse madrilène contre le journal carliste El Siglo Futuro et les dirigeants politiques du mouvement, les Nocedal, père et fils et autres… Mais ici à Oviedo, il a pu apprécier l’intégrité morale de ses collègues. Rien à voir avec les métis de la Unión Católica qui ne sont qu’une « pourriture spirituelle » plus néfaste que tout.
Tous déclarent, convaincus, que l’évêque s’est fourvoyé en insérant précipitamment dans sa pastorale ce paragraphe qui injurie le professeur Alas en des termes inacceptables et manifeste un intolérable mépris pour le corps universitaire. Tous sont décidés à réagir. Tous attendent que s’exprime Leopoldo Alas.
Lui, il annonce qu’il se propose d’exiger de Son Excellence une rectification publique des contre-vérités qui lui ont servi de prétexte pour attenter à l’honneur d’honnêtes universitaires. De fait, il a rédigé une longue lettre adressée à Monsieur l’Evêque et il va la publier dans un journal local. Ses collègues lui demandent de lire la lettre. Ce qu’il va faire, mais au préalable, il avoue qu’il ne pouvait pas laisser passer cette occasion de s’en prendre à un évêque et qui plus est, un évêque affidé de Pidal. Pendant la lecture, il observe que des passages ironiques éclairent d’un sourire certains visages. Barrio y Mier et Estrada, en particulier, ne cachent pas leur satisfaction amusée. Pour eux cet évêque qui doit sa nomination à Pidal a fait un faux pas et ils ne sont pas mécontents d’enfoncer le clou. Ils déclarent qu’ils vont eux aussi, au nom du corps universitaire, publier une mise au point dans la presse pour faire savoir que rien de ce qu’affirme l’évêque ne s’est passé et que donc Monseigneur a commis un impair. On verra comment il s’en sort.
La lettre ouverte adressée par les professeurs carlistes à Fray Ramón Martinez Vigil est publiée dans le journal local conservateur El Carbayón le 11 mai 1885 :
Monseigneur :
C’est avec une réelle surprise que nous avons vu, consigné dans un document pastoral de V. Exc., que, il y a quelques jours de cela, tous les élèves d’un cours de Droit ont reçu en guise de récompense et d’encouragement, un livre auquel V. Exc., faisant usage de son ministère sacré, fait de graves critiques. Comme l’allusion semble se référer à notre Université, nous affirmons devant V. Exc., sur notre parole d’homme d’honneur et notre foi de chrétiens, que nous n’avons pas eu la moindre nouvelle d’un tel fait et il n’était d’ailleurs pas possible que nous en eussions, car après toutes les vérifications que nous avons faites pour en connaître le détail, ce fait n’est en aucune façon avéré, au point qu’aujourd’hui nous croyons en conscience que sont parvenues à V. Exc. des informations ou affirmations complètement infondées.
Puisse V. Exc. daigner accepter cette rectification et, pour notre part, nous avons espoir qu’elle sera suffisante pour nous justifier auprès de V. Exc. s’agissant de vos appréciations, pour lesquelles nous manifestons un profond respect. Il suffit qu’elles proviennent de l’autorité ecclésiastique, la seule que nous ne nous permettrions jamais de questionner quant à l’opportunité et la portée qu’aurait notre protestation officielle ou officieuse, si seulement le fait mentionné était avéré.
Nous espérons également que V. Exc. trouvera très naturel que nous nous adressions à la presse, pour que cette explication parvienne au public, en défense de notre bon renom de professeurs intégralement catholiques, car mettant cette qualité au-dessus tout, nous nous faisons un point d’honneur de toujours agir en tant que tels.
Nous baisons l’anneau de V. Exc. Vos humbles fils qui avec affection et respect vous saluent,
Guillermo Estrada y Villaverde, Matías Barrio y Mier, Víctor Díaz Ordóñez y Escandón, Justo Álvarez Amandi, Oviedo, 11 mai 1885
Ce style de courtoisie consacré, gonflé jusqu’à l’emphase, adressé à un évêque marri ou courroucé contre lui-même pour s’être malencontreusement laissé tromper, a quelque chose d’hyperbolique qui frise le burlesque. Certaines formules résonnent comme des antiphrases. Ce prélat trouvera-t-il « très naturel » que la lettre soit adressée à la presse ? Ces formules hyper-courtoises font office de couches de coton sensées atténuer la douleur du couteau que l’on retourne dans la plaie, alors que le dard de l’ironie blesse le destinataire et fait sourire le lecteur.
Ses collègues carlistes ont trouvé la forme la plus efficace pour venger l’honneur bafoué des universitaires, celle qui affirme haut et fort le plus grand respect pour la fonction épiscopale tout en laissant entendre que dans ce cas précis il y a une faille qu’il convient de mettre au jour.
Lui, il comprend très bien que ses collègues ne pouvaient pas aller plus loin, c’est-à-dire amorcer une certaine défense de sa personne et de l’objet du scandale. La Regenta n’est pas citée, le mot roman n’est pas formulé. Il s’agit seulement « d’un livre auquel V. Exc. faisant usage de votre ministère sacré, fait de graves critiques ». Athéisme, corruption, érotisme…
C’est à lui de répondre de ces accusations et c’est chose faite le lendemain, comme savent tous ses collègues et c’est chose publique dans El Eco de Asturias. Diario liberal y democrático du 12 mai 1885.
Bien en vue en haut de page, est reproduite la rectification que les étudiants de la classe de Droit romain ont fait parvenir à l’Évêché :
Les soussignés, élèves du cours de Droit romain de cette université déclarent : que leur très respectable professeur D. Leopoldo García Alas, non seulement ne leur a pas distribué des exemplaires de son œuvre La Regenta, ni au sein ni à l’extérieur du cours, et qu’ils n’ont entendu provenant de ses lèvres aucune phrase qui pût avoir un rapport avec ladite œuvre.
Ce que, à toutes fins utiles et en triple exemplaire, certifient…
Suivent les signatures des vingt-neuf étudiants, dont la première est celle de Gaspar C. Jovellanos, celui qui par son mensonge a déclenché la réaction de l’évêque.
Vient ensuite le texte de sa lettre ouverte :
Son Excellence Don R. Martínez Vigil, évêque d’Oviedo
Oviedo, 11 mai 1885.
Cher monsieur :
Je commence en faisant appel à la charité de V. Exc. afin d’obtenir par avance le pardon de tous les concepts ou phrases de cette lettre qui pourraient ne pas être dignes d’être présentés devant un personnage aussi éminent que vous dans le domaine temporel et dans le domaine religieux. C’est la première fois que j’écris à un évêque, et je crains de ne pas me montrer aussi courtois et mesuré que je me le suis promis, cela, bien que dans la pastorale de V. Exc. vous me qualifiez de « brutal agresseur de l’honneur d’honnêtes gens », moi ou sinon un livre de moi, parce que, à dire vrai, la grammaire du paragraphe que je vais recopier n’est pas très claire, sans doute en raison de la hâte mise à rédiger le document. Le fait est que dans ladite pastorale, en date du 25 avril de la présente année, il est fait allusion à un roman qui doit être de moi, non pas en raison des épithètes dont V. Exc. ornemente le livre, mais parce qu’il y est précisé que l’auteur est professeur de Droit, et parmi ceux de cette Faculté, à Oviedo, il n’y en a qu’un qui, bien qu’indigne, écrive des livres de ce genre, et il s’agit de moi. Bon nombre de mes collègues pourraient se consacrer au roman avec beaucoup plus de bonheur que moi, mais le fait est qu’ils ne s’y consacrent pas.
On aurait aimé qu’il y eût autant d’exactitude dans ce que V. Exc. dit à propos de ce roman de moi, dont un second tome sera publié sous peu. V. Exc. affirme que « il y a seulement quelques jours de cela des élèves d’un cours de Droit ont reçu un livre saturé d’érotisme, de dérision aux pratiques chrétiennes (dérision à n’est pas correct, Excellence, mais je continue à copier) et d’allusions injurieuses ». Si je me fie à ce qu’on a dit de mon roman intitulé La Regenta et parce qu’il me semble que c’est à lui que vous vous référez, je me considère comme concerné ; mais pas par l’exactitude des attributs. Le cours de Droit auquel il est fait allusion doit être celui de l’auteur, le mien, celui de Droit romain, et c’est dans ce cours que V. Exc. assure qu’a été distribué un livre saturé de trois choses, en guise de récompense et d’encouragement. Monsieur l’évêque, il n’y a malheureusement pas un seul mot de vrai dans tout cela. Et je dis malheureusement car il eût été préférable pour la cause de la moralité et de la religion, que moi, pauvre pécheur laïque, commisse l’imprudente sottise de distribuer dans sa classe des livres de littérature récréative, un tant soit peu dangereuse pour des jeunes gens de quinze ans (un peu au-delà de proximi pubertati[1]) ; je dis qu’il eût été préférable que je commisse une aussi formidable imprudence plutôt que ce qui s’est produit, à savoir qu’un évêque affirme dans une pastorale des faits absolument erronés, au plus grand dam de l’honneur d’un professeur qui par concours, en juste lice, a remporté sa chaire, le pain de sa famille, et pourrait voir son poste menacé, par l’ouverture d’une enquête administrative, s’il ne disposait pas des moyens de prouver que V.Exc. s’est faite l’écho, à coup sûr sans mauvaise intention, d’une infâme et stupide calomnie.
Je ne sais l’idée que V. Exc. peut se faire de ma parole d’honneur ni du Dieu en qui je crois, mais à toutes fins utiles, je jure sur Dieu et donne ma parole d’honneur que tout ce que la pastorale dit à propos de la distribution de livres en classe est faux ; que pas plus au sein qu’en dehors de mon cours je n’ai donné à un seul de mes élèves, et encore moins à l’ensemble, un seul exemplaire de mon roman ; et que je n’en ai pas fait mention en classe, même incidemment. De romans, il y en est souvent question ; mais, Excellence, c’est de ceux que publièrent Justinien et d’autres empereurs. Et je jure à nouveau tout ce que j’ai juré.
Mais comme à en juger par un autre passage de la pastorale, V. Exc. n’a pas une très bonne opinion ni de mon honneur ni de mes croyances, j’ai des preuves d’une autre nature, auxquelles le plus obstiné à me calomnier devra se rendre. Répondant à une suggestion qui n’est pas venue de moi et ayant accueilli l’idée avec enthousiasme, tous les élèves qui assistent à mon cours ont signé une déclaration démentant catégoriquement l’affirmation calomnieuse dont sans le vouloir V. Exc. s’est faite l’écho. Je sais que cette déclaration, suivie de 29 signatures, celles de toute la classe, est parvenue aux mains de V. Exc. et je m’en remets à cette preuve.
Si ce n’était peut-être un manque de respect, à ce stade, je pourrais ici m’étonner de ce qu’une personne aussi éclairée que l’évêque d’Oviedo, qui doit si bien connaître le cœur humain et le commerce des livres en Espagne, ait pu croire qu’un auteur de romans, qui vit de leur vente (gagnant ainsi, sinon son déjeuner, du moins son dîner) ait pu devenir fou au point d’offrir des exemplaires de son œuvre à tous les élèves de son cours.
Vingt-neuf ou trente exemplaires en cadeau ! Ah Monseigneur, je n’ai pas autant d’élèves dignes de récompense, et ma munificence ne va pas jusque-là. En début d’année, j’ai l’habitude d’offrir à trois ou quatre élèves méritants un petit livre de moi, didactique, intitulé Le Droit et la moralité, parce que cela me semble mieux que de le leur faire acheter. Mais cet opuscule dont je ferai aussi présent à V. Exc. si elle veut bien me faire l’honneur de l’accepter, n’est pas érotique et on n’y parle d’autres prêtres que de Saint Thomas d’Aquin, Taparelli et quelques autres comme eux, que je porte au pinacle, comme ils le méritent, ce que V. Exc. sait fort bien.
Au reste je crois que mon roman est moral, parce qu’il est une satire de mauvaises mœurs, sans qu’il soit besoin de faire d’allusion directe à quiconque. Ainsi, par exemple, entre mon évêque don Fortunato Camoirán et l’actuel évêque d’Oviedo personne ne pourra voir la moindre ressemblance. V. Exc. dispose d’un attelage, mon don Fortunato n’en a pas ; mon Camoirán avait des souliers rapiécés, et V. Exc. est bien chaussé. Les vertus que je me plais à reconnaître chez V. Exc. pourront être supérieures à celles de mon don Fortunato, mais elles sont d’une autre nature. Mon Caimorán ressemble davantage, par exemple, à l’inoubliable Benito Sanz y Forés, archevêque de Valladolid, digne prédécesseur de V. Exc. Et si nous descendons un peu plus dans la hiérarchie je trouve que mon don Fermín de Pas, chanoine et proviseur, ne ressemble à aucun chanoine d’Oviedo, car j’attribue à mon héros imaginaire des vices que personne n’a ici, un talent que beaucoup de prébendés d’ici pourront avoir, mais pas au niveau supérieur, frôlant le génie, que je me plais à attribuer au produit de mon imagination. Par contre, depuis Barcelone, depuis les Canaries depuis Saragosse depuis Murcie, on m’a écrit qu’il y avait beaucoup de prêtres semblables aux miens. Il faut voir comme sont les gens, Monseigneur, et toutes les idées qu’on peut se faire.
Mais je laisse de côté ce point particulier parce que je n’ai pas un spécial intérêt à démontrer à V. Exc. la bonté morale de mon roman, considérant surtout qu’il est tout sauf possible que nous arrivions à nous entendre, sauf à ce que je cesse d’être qui je suis ou vous d’être évêque, chemin que je ne vous vois pas prendre, car V. Exc. doit plutôt être destiné à être archevêque, comme le mot lui-même l’indique[2]. C’est pourquoi je trouve à sa place —car, pour ma part, j’aime que tout le monde ait le droit de vivre— tout ce que dans la pastorale il est dit de mon livre, et seule me pousse à écrire la fausse affirmation à propos de la distribution du roman en classe.
Et pourtant peut-être y-a-t-il dans la façon de me blâmer (surtout sur le fait d’injurier des personnes particulièrement respectables et d’être un brutal agresseur de l’honneur d’honnêtes gens), peut-être y aurait-il là matière suffisante, comme dirait Calderón[3], pour un procès ; mais pas plus que je n’ai suffisamment confiance dans les procès qui à certaines époques prennent certaines formes, il serait rien moins que particulièrement irrévérencieux de convoquer un évêque à un acte de conciliation, comme me l’ont conseillé quelques libres penseurs outranciers dont, sur le mode de l’imitation littéraire, je dis quelques mots dans le second tome de mon roman, comme V. Exc. le verra le moment venu.
Ce que j’espère en revanche c’est que, tout en laissant la pastorale en l’état, s’agissant des insultes que vous me prodiguez et que, parce qu’elles viennent de qui elles viennent, je pardonne et qu’en plus elles ne sont que poudre mouillée, car à un évêque on ne peut ni ne doit demander réparation sur un autre terrain, je dis donc que laissant la pastorale en l’état, avec toutes ses saturations, j’espère que V. Exc. daignera, en accord avec l’esprit et la lettre de l’Évangile, apporter une rectification à la fausse affirmation dont je fais état. Quant à la forme de la rectification que je sollicite de votre bienveillance, il est clair que V. Exc. choisira celle qui lui sera la plus agréable. Mais je suis sûr que vous préfèrerez la plus adéquate et puisque c’est de façon publique et imprimée que l’erreur a été portée à la connaissance du diocèse, c’est justice que la vérité qui l’effacera soit vue par le public en lettres d’imprimerie. Mais comme l’affaire ne mérite pas une autre pastorale, et que je ne crois pas que, s’agissant de pastorales, il soit d’usage de publier des errata (puisque la coutume veut que celles qui sont publiées soient bien pensées et corrigées) il est évident que, préférable à tout, serait une simple rectification par voie de Presse, dont je me sers moi aussi en envoyant à celle-ci une copie de cette longue épitre, que je souhaiterais aussi respectueuse dans la forme qu’elle l’est dans mon intention.
Et il me faut dire ici que si la perspicacité littéraire et expérimentée de V. Exc. voulait voir dans ce que j’écris des traits d’ironie d’une quelconque des trois espèces d’ironie énoncées par Hermosilla[4], il m’appartient de déclarer qu’il n’y en a pas la moindre trace, le moindre trait ou soupçon, qu’ici il n’y a pas d’antiphrase, c’est l’évidence même ; il serait absurde de penser qu’il puisse y avoir du sarcasme, et de l’autre sorte d’ironie, dont présentement je ne me rappelle pas le nom[5], je donne ma parole qu’il n’y en a pas non plus. Il ne serait pas étonnant, cependant, qu’on puisse avoir une autre impression, car sous ma plume subsistent des relents que je combats en vain du temps où j’écrivais dans Gil Blas, El Solfeo et d’autres journaux[6] que, s’ils étaient encore en vie aujourd’hui, V. Exc. condamnerait avec la même diligence qu’elle met présentement à blâmer mon roman et que celle employée par d’autres prélats à condamner le discours de mon bon ami Morayta discours que le ministre de l’Intérieur selon ces respectables mitrés, a distribué aux étudiants. Distribution il y a bien eu en l’occurrence, faite par le ministre ou quelqu’un d’autre, mais s’agissant de celle que V. Exc. m’attribue, qu’il soit bien établi qu’il n’y en a mie.
Et qui peut bien être le calomniateur qui qui est allé souffler dans votre oreille ce venticello comme dit don Basile[7] ? (Je retire la citation si elle est irrévérencieuse). Cet infâme doit me vouloir bien du mal, mais c’est à coup sûr un ennemi mortel de Votre Excellence. Voilà un type tout trouvé pour un autre roman de mœurs d’Oviedo, monsieur l’évêque. Du reste, V. Exc. ne doit pas être marri de ce qui est arrivé, parce que c’est le propre de l’homme que de se tromper, même lorsqu’il s’agit d’évêques. Il en irait autrement si V. Exc. était monté sur le siège de Saint-Pierre (ce que personnellement je vous souhaite), parce qu’alors l’erreur ferait mauvais effet.
Et je conclus, enfin, Monsieur l’évêque, en baisant tous les précieux attributs qu’il est d’usage de baiser en de telles circonstances, et dont je pense qu’il s’agit de l’anneau pour ce qui relève du divin et, pour ce qui est de la politesse, de la main.
Et de V. Exc. je suis, en outre, le très dévoué serviteur
Leopoldo Alas
Trois jours plus tard, Leopoldo reçoit la réponse obligée de Fray Ramón Martínez Vigil : un très laconique petit mot, comme s’il s’agissait d’expédier une affaire de peu d’importance :
M. Leopoldo Alas
Cher monsieur :
Si comme vous l’assurez dans votre lettre du 11 courant, ce que je crois, vous n’avez pas distribué à vos élèves le livre en question, ou que certains croient visé dans ma pastorale du 25 du mois dernier, je me plais à le reconnaître et vous en félicite.
Votre très dévoué serviteur et prêtre
L’Évêque d’Oviedo
15 mai 1885
Par contre, aucune réponse à la lettre ouverte des professeurs, aucune excuse pour les professeurs de l’Université, plus aucune allusion à l’affaire dans les pastorales qui suivent. Ce silence n’est certainement pas oubli. La sainte colère qui soulevait le prélat quand il lisait La Regenta s’est certainement figée, après l’incident public, en rancœur, une rancœur tenace, enfermée pour le moment dans les murs de l’évêché, mais prête à se répandre en haine dans les quartiers réactionnaires de la vieille cité et à s’écouler tout au long des méandres de l’Espagne ultra-catholique.
Et la pastorale ? C’est seulement une bonne semaine après l’incident que lui vient à l’esprit que le texte lu par Adolfo Posada n’était qu’une petite partie de la fameuse pastorale. Il trouve aisément celle-ci dans les bureaux de l’Administration universitaire. Il n’est pas peu surpris de lire que la Pastorale de l’évêque d’Oviedo est la reproduction de la Pastorale des prélats de la province ecclésiastique de Valladolid adressée au clergé et aux fidèles du diocèse à propos des « conséquences pernicieuses de la liberté de la presse et de la liberté d’enseignement » quand c’est la « mission exclusive de l’Église que d’éduquer tous les peuples ». Son auteur est… Benito Sanz y Forés ! et l’évêque d’Oviedo en exercice s’est contenté d’y ajouter, à l’intention de ses « bien aimés diocésains » quelques propos de son cru, dont ceux-ci :
« Dans un pays qui compte dix-huit millions d’habitants – parmi lesquels à peine dix-sept mille individus dissidents du catholicisme et ceux-ci étrangers pour la plupart – il est évidemment inconcevable que nous rétrogradions aux temps de Platon, pour chercher cette très belle vertu : Justitia de cœlo prospexit. La justice nous vint du ciel : la justice est la religion catholique. Et comme la religion catholique est le résumé de tous les biens que le créateur concède à sa créature préférée, est le plus grand de ses dons et un don connu et envié par dix-sept millions d’espagnols, la société espagnole ne pourra retrouver l’équilibre perdu que lorsque les lois seront informées par l’esprit catholique et lorsque les institutions, l’enseignement, la presse seront catholiques.
Aujourd’hui, nous catholiques, nous sommes victimes d’une tyrannie que nos adversaires impartiaux devraient reconnaître. Alors que la Constitution de la Monarchie… ».
Vient la partie explosive du texte « contre ce brutal agresseur de l’honneur d’honnêtes gens ». Lui.
Et l’évêque d’Oviedo poursuit :
« Il en est de même avec la presse impie et immorale. En vain la Constitution interdit les manifestations publiques contraires à la religion ; en vain l’article 3 du Concordat en vigueur promet son soutien aux évêques dans leur lutte contre les publications et le livres pernicieux ; en vain se multiplient les délits et les crimes en tous genres : les Evêques attentifs au salut des âmes et à la tranquillité publique, interdisent ces nocives productions et les autorités ne bougent pas, et dans les rues et sur les places se vendent à la criée les périodiques interdits, se moquant publiquement des excommunications épiscopales. De sorte que, si l’on obtient quelque résultat, comme grâce au ciel c’est le cas dans notre diocèse, on le doit uniquement à la piété et à l’obéissance des fidèles… ».
Le discours de l’évêque d’Oviedo est le même que celui de tous les prélats actuels. Hors du catholicisme point de salut pour la société et pour l’individu ! Seule l’Église catholique est apte à diriger les institutions, l’enseignement, la presse, tout, elle devrait tout contrôler car elle seule est la Vérité. Pour lui, ce que concède l’article 11 de la Constitution, la pratique privée d’autres cultes, protestant par exemple, c’est déjà trop. Ce totalitarisme a une odeur d’Inquisition, d’autant plus forte qu’il se lamente de la mollesse des pouvoirs publics, c’est-à-dire de l’inaptitude actuelle à la répression du bras séculier. Prison, question, autodafé tout cela doit leur chanter dans la tête à nos évêques et archevêques, tous authentiques disciples de Saint Dominique, le fondateur de Inquisition ! Il savait tout cela, mais il est peiné que son bon évêque Sanz y Forés, lui aussi, le rappelle dans sa pastorale.
Pour l’heure, comme journaliste qui sait comment fonctionne la presse, il est convaincu que l’incident d’Oviedo aura une résonance nationale. D’ailleurs, il s’y emploie lui-même en envoyant des lettres à ses amis de Madrid. Il sait que les articles importants publiés dans la presse locale sont repris, en général, dans les journaux de la capitale et d’autres villes de province. C’est pourquoi, il passe tous les soirs au Casino de la Plaza Porlier lorsque la presse nationale, arrivée vers les cinq heures, est déposée sur les tables du salon de lecture.
Effectivement, les journaux libéraux de Madrid, El Liberal, El Globo, Madrid Político, La República (ce dernier affichant un grand titre en première page : « Gaffes épiscopales »), etc. ne pouvaient pas laisser passer l’occasion de mettre en exergue cette faillibilité cléricale et pour ce faire ils publient la lettre de Leopoldo Alas, de Clarín, ou une partie de celle-ci. Le journal anticlérical El Motín du 24 mai, à propos « de brutal agresseur de l’honneur d’honnêtes gens », écrit, selon son habituelle ironie de combat : « C’est une horrible insulte qui équivaut à le [Clarín] traiter de curé ». « L’erreur est le propre des évêques ! », tel est le titre moqueur d’un article consacré à la polémique d’Oviedo par la fameuse feuille des libres penseurs, Las Dominicales del Libre Pensamiento (24 mai 1885). Soit dit en passant, El Motín et Las Dominicales del Libre Pensamiento sont souvent critiqués par lui, Clarín, pour leur exclusivisme et leur anticléricalisme superficiel et donc contreproductif.
En mai 1885, pour lui, le plus important n’est pas cette polémique. Certes, il a pris plaisir à écrire cette lettre à l’évêque, il a retrouvé la vivacité satirique du journaliste qu’il était quand il collaborait, à Madrid avec les journaux d’opposition, mais en mieux car cette fois s’adressant directement à un prélat il lui semblait avoir trouvé le vrai ton d’une l’ironie bien mesurée afin qu’elle soit plus incisive…
L’important, c’est La Regenta qui s’achemine sans coup férir, au prix d’efforts nocturnes soutenus vers son point final. Début mai, c’est chose faite. Dans une lettre à son ami José Quevedo, il laisse éclater sa joie, sa satisfaction, su orgueil : « Quelle étrange émotion que celle d’achever pour la première fois de ma vie (à trente-trois ans) une œuvre d’art ! ». Et il ajoute qu’il se sent libéré de la fatigue de chercher les lois probables de la vie intérieure et les raisons vraisemblables de la vie extérieure d’Ana Ozores et du Magistral.
Début juillet, les paquets envoyés par Cortezo s’empilent dans la librairie de Martínez. Comme il l’a fait pour le premier tome, il s’empresse d’envoyer des exemplaires à ses amis de Madrid, Picón, Galdós, Pereda, Francisco Giner de los Ríos, Castelar…, car il a hâte de savoir si ce deuxième tome est apprécié. Au cours de l’été dans son refuge de Guimarán, il reçoit une lettre élogieuse de Francisco Giner, maître vénéré, qui le rassure. Particulièrement agréable lui est la réponse de Pereda car il lui avoue qu’il envie sa capacité à sonder la psychologie des personnages et va jusqu’à écrire, lui l’admiré Pereda : « C’est ce qui me manque pour parvenir au bout de mon désir d’écrire le roman que je sens bouillir en moi : savoir fouiller les âmes avec la subtilité qui est la vôtre ». Le bon Picón lui fait savoir qu’il va publier un article élogieux sur ce deuxième tome. Par contre, son si admiré Galdós avoue fin septembre qu’il n’a pas encore lu le livre, reçu en juillet ! Il est très déçu, lui qui est, en quelque sorte, le critique attitré du grand romancier et qui attend surtout un jugement de la part de l’auteur de La desheredada.
Selon le libraire Juan Martínez, il est certain que la polémique avec l’évêque et la publication de sa lettre dans la presse nationale ont été des facteurs actifs de propagande. Ainsi donc, Monseigneur aura contribué à faire connaître et à faire vendre ce roman saturé de toutes ces vilaines choses.
De fait, durant les mois qui suivent, de nombreux articles plus ou moins élogieux paraissent dans les principaux journaux libéraux ou républicains de Madrid et de Barcelone. Il est satisfait de ce qui est dit du livre dans la presse et dans les missives qu’il reçoit. Il est d’accord avec ceux, et ils sont nombreux, qui pensent que le grand défaut de ce roman c’est sa longueur ; il n’est pas bon, dans les conditions actuelles de lecture, qu’un roman couvre deux tomes. Même de France lui arrive un exemplaire de la Revue du Monde Latin avec un article intéressant du prestigieux hispaniste Boris de Tannenberg et, un peu plus tard, un autre de La Revue Britannique avec un texte élogieux de F. B. Navarro.
Il ne s’attendait pas à ce que son ami Miguel Moya, directeur de El Liberal, prenne sa défense contre… Guillermo Estrada, son collègue qui, après s’être solidarisé (tactiquement) avec lui lors de la polémique avec l’évêque passe à l’attaque, comme traditionnaliste, contre la néfaste influence du « roman actuel ». Mais cela ne l’étonne pas de la part d’un carliste intégral.
Reste à savoir ce qu’Estrada entend par néfaste influence. La satire trop poussée des coutumes et des mœurs cléricales ? L’impact que peut avoir sur le lecteur la vision de l’érotisme que lui a imposée l’observation de la réalité humaine du monde de Vetusta ? C’est, en effet, un reproche récurrent qui lui est fait. Déjà, à propos du premier tome, il se souvient qu’un critique avait écrit qu’il y avait là « un excès de physiologie » que le « tableau dressé de Vetusta était bien noir avec certains relents de porcherie ». Son ami Pereda lui reprochait les « nombreux détail crus et même obscènes » et il ajoutait qu’il devrait « cacher ce roman afin qu’il ne tombe pas entre les mains inexpertes de [son] fils aîné ». Même Galdós dans sa lettre du 6 avril lui reprochait de donner trop de place à la luxure car dans la représentation littéraire il convenait de mettre un voile sur ces choses à l’instar de notre « culture » qui les dissimule. Et en septembre, après avoir enfin lu le deuxième tome, il réitère cette critique : « Je persiste à croire —écrit-t-il dans sa lettre— que les appétits charnels n’ont pas une aussi grande importance dans les actions humaines que celle que vous semblez leur donner dans votre magnifique tableau de Vetusta […] Cette œuvre est un peu trop lascive ». Que peut-il répondre ?
D’abord qu’il n’est pas d’accord avec l’affirmation qu’en art il ne faut pas aller à l’encontre de « notre culture », c’est-à-dire de la morale dominante qui, en l’occurrence, n’est qu’un paravent qui « dissimule », donc une morale de façade. Le romancier moderne, le romancier naturaliste recherche la vérité de l’objet qu’il observe ; à lui ensuite de trouver la forme artistique adaptée. Pérez Galdós sait bien que la sensualité est un agent actif de la vie humaine, ses romans le suggèrent, mais il semble ne pas oser aller au-delà de la suggestion, en accord avec sa position timorée. Lui pense au contraire que le romancier naturaliste doit dépasser les barrières et approfondir ces intérieurs enfumés. C’est ce qu’osent faire Flaubert et Zola ; la fausse morale réactionnaire même en France leur fait des procès qui ne font que renforcer leur notoriété. Il se laisse aller à revivre brièvement certains de ses personnages de Vetusta et des images défilent :
la sensualité accrocheuse de l’ondulante Obdulia,
la sensualité frustrée et malheureuse de Saturnino Bermúdez
Álvaro Mesía, le cacique libéral, don Juan vieillissant, proche de l’impuissance, superficiel et vaniteux,
Fermín de Pas, le Magistral, chanoine athée, dont la sensualité fait éclater le carcan de la soutane qui l’emprisonne,
le palais du marquis de Vegallana, emporium de débauche effrénée,
même son Ana Ozores, en constante recherche d’un idéal sublimé, ne peut échapper à cette poussée de vie qu’elle transpose en élan romantique, pour son malheur.
……………………………………………………………
Oui, dans cette société de bourgeois et d’aristocrates plus ou moins oisifs, la sensualité est un moteur d’activité que le romancier a le devoir de dévoiler et son arme artistique la plus efficace est l’ironie et ses multiples facettes.
En contrepoint, la classe populaire des travailleuses et des travailleurs, qui, après la journée de labeur, envahit le soir le Boulevard révèle sans fard et dans la joie une énergie génésique forte et naturelle.
À Oviedo, sauf la recommandation de La Regenta « contre les insomnies » par un hebdomadaire satirique, la presse est restée obstinément silencieuse.
Il n’est pas mécontent de son premier essai de roman, mais maintenant devant son avenir de romancier, il ne se sent pas très sûr de lui. Sera-t-il capable d’écrire un autre roman qui le satisfasse autant que La Regenta ? En tout cas, il a déjà vendu le prochain, Su único hijo, à l’éditeur madrilène Fernando Fe, sans en avoir écrit une ligne. Quand il est en disposition, pas très souvent, il se consacre à ce nouvel ouvrage, mais il ne retrouve pas ce fébrile enthousiasme qui le poussait à écrire durant des nuits et des nuits. Et puis, son imagination créatrice envahit son esprit d’un tourbillon de projets de romans auxquels il donne un titre, Una medianía, Bárbara, Juanito Reseco et il va de l’un à l’autre pour revenir au plus avancé, Su único hijo qui, finalement n’avance guère. Ces hésitations traduisent un manque de confiance en ses aptitude de romancier, lui qui excelle dans le fragmentaire, l’article journalistique et dans le domaine littéraire, le conte et la nouvelle, surtout le conte.
En vérité, il ne se sent pas en bonne santé. Il y a quelques mois, il écrivait à doña Emilia Pardo Bazán qu’il enviait chez elle cette force d’éternelle jeunesse qui subsiste même après la disparition de la jeunesse physique. Il lui avouait qu’il se sentait devenir vieux à grande vitesse, à trente-huit ans, qu’il avait des problèmes de vue et ne pouvait lire de manière prolongée. Mais il ajoutait que malgré ces faiblesses, son moral n’était pas altéré et que sa pensée religieuse était plus ferme que jamais. « Mon grand désir —écrivait-il— serait d’avoir assez d’argent pour pouvoir consacrer toute ma vie à écrire un livre démontrant que Jésus, bien qu’il ne pût être Dieu, car ce serait une atrocité, sera l’éternelle consolation spirituelle des cœurs bons et une image virtuelle dans l’histoire des miroirs idéaux de l’avenir ». Oui, pour lui la divinité de Jésus a toujours été inconcevable et il est devenu un disciple inébranlable de Renan tant admiré alors que détesté par les catholiques espagnols et même combattu par son ami Marcelino Menéndez Pelayo, pourtant catholique très cultivé.
Au cours des années 1889-1891, il a conscience d’avoir retrouvé la plénitude de ses activités journalistiques. Il est le collaborateur assidu d’une dizaine de périodiques nationaux et américains, argentins surtout ou il publie des articles de critique littéraire, des articles politiques, des fragments de réflexions philosophiques et religieuses, des contes. Enfin, en 1891, l’éditeur Fernando Fe de Madrid lui envoie son deuxième roman Su único hijo (Son fils unique) qu’il a mis six ans à écrire !
Au cours de cette intense activité intellectuelle, il rencontre fortuitement dans la presse l’évêque d’Oviedo. Celui qu’il qualifie dans un journal de Barcelone de « pidalin » et de « gratte-papier » est l’auteur d’un roman ! Et il écrit dans une lettre à un ami : « Un roman intitulé Celia, ou Lelia, ou Delia, bref un nom de chienne, dans lequel est décrit l’appartement d’une demoiselle qui comprend (l’appartement) plusieurs dépendances : salon, deux cabinets, toilettes et, selon le prélat, les murs de toutes ces pièces sont recouverts d’images pieuses ». En fait, ce ne doit pas être un roman, plutôt un tableau de mœurs qui figure avec d’autres dans un ouvrage consacré à la vie madrilène et intitulé Cartas de Madrid. Pour le critique qui lui révèle l’existence de cette œuvre, ces chroniques sur les bas quartiers de Madrid, les théâtres, les salles de bals sont indignes d’un évêque.
Pour saluer cette prouesse littéraire de l’évêque, il attribue, dans la presse, à celui-ci le pseudonyme que s’est donné un jeune écrivain, Emilio Bobadilla, dont le talent n’est absolument pas à la hauteur des prétentions, Fray Candil (Frère Falot). Son Frère Falot proclamé est son évêque, ce qui met en fureur Bobadilla, dépossédé de son pseudonyme, qui, dès lors, oubliant qu’il lui doit la petite notoriété dont il jouit actuellement, se déchaîne contre lui avec violence, le traitant d’hystérique, qualifiant de pathologique son évolution religieuse, etc. Goguenard, il fait semblant de s’excuser : « J’avais oublié ce jeune homme —écrit-t-il dans Madrid Cómico du 23 janvier 1892— et sans m’en rendre compte, commettant une notable bêtise, j’ai pris à Frère Falot le pseudonyme comme une chose abandonnée pour l’appliquer à l’évêque d’Alejandrópolis, qui existe bien, est moine et écrit des romans ». Et poursuivant, il ajoute : « Il est patent que l’évêque d’Oviedo ne voit pas d’un bon œil les professeurs de l’Université, et plus particulièrement lui, Clarín, et qu’il appuie toutes les entourloupes du grand cacique Alejandro Pidal ; il est vraiment l’évêque d’Alejandrópolis ».
Entretemps, la querelle avec Bobadilla s’envenime. Les injures que celui-ci vocifère dans la presse, le poussent à défier au sabre l’impertinent.
Quand en février, il est à Madrid dans un jury de thèse, le duel a lieu le 20 et s’achève sans trop de dégâts ; quelques égratignures de part et d’autre et pour lui une légère blessure à la lèvre à la suite d’une chute.
À son retour à Oviedo, il apprend que certaines personnes de Vetusta sont au courant de tout ce qu’il a fait à Madrid. C’est encore un coup du curé Angel Rodríguez Alonso, le fameux Angelón qui, dans sa feuille intégriste La Victoria de la Cruz, ne cesse depuis quelque temps de s’en prendre à lui. En effet, il sort le 22 mars un article vénéneux :
Ce matin, dans la banlieue de Madrid, a eu lieu le duel entre l’éminent critique et romancier Don Leopoldo Alas (Clarín) et Don Emilio Bobadilla. Le duel était au sabre il y eut deux assauts, à la suite desquels Monsieur Alas s’en tira avec une contusion au bras gauche et une autre à la bouche et Monsieur Bobadilla, une égratignure sur un bras.
Ce duel a montré que Clarín devrait surveiller sa bouche, car le critique, comme le poisson meurt par la bouche […]
Pauvre Clarín !
Aller par le monde pour gagner quelques misérables pesetas avec sa plume pour en arriver là. Pour qu’on lui porte des coups de sabre sur la bouche !
Cette prose, comme toutes les piques d’Angelón, le fait sourire ; par contre, il se demande ce que peut bien en penser son évêque, qu’il imagine de temps à autres à l’affût des gestes et des écrits de son redouté Clarín.
……………………………………………………………
En fait, Leopoldo Alas ne saura jamais que ce Frère Falot, cet évêque d’Alejandrópolis, s'est empressé de le dénoncer, dès le 23 mars, auprès du Ministre de Fomento, qui par chance, peut-être, n’est plus Pidal, mais un certain Linares, politicien conservateur, lui-aussi de l’écurie de Cánovas :
Excellence :
Selon plusieurs périodiques et Votre Excellence peut prendre connaissance de l’un d’eux dans la coupure de presse ci-jointe, le professeur de Droit romain de cette Université, Don Leopoldo Alas, vient de se battre en duel dans les environs de Madrid. Il y a un peu plus d’un an, ce même professeur provoqua un autre scandale en se moquant cyniquement des dogmes catholiques et des autorités ecclésiastiques dans un journal américain. Sans préjudice de m’occuper de cette affaire au Sénat, si nécessaire, je me permets de la porter à votre connaissance, accomplissant ainsi le devoir imposé par ma charge de Pasteur d’un peuple obligé de livrer ses enfants à la direction littéraire d’un tel professeur.
Que Dieu garde Votre Excellence de nombreuses années.
L’évêque ne ment pas quand il accuse Clarín de s’en prendre à l’institution catholique figée dans la routine des dogmes et de critiquer vertement, du plus haut au plus bas de la hiérarchie, ce clergé quand il faillit à sa mission et il ne mène pas cette lutte uniquement dans un journal américain, mais dans toute la presse libérale ou républicaine où il publie ses articles et depuis toujours. Par exemple, dans La Publicidad, il a écrit : « Il y a mitres et mitres. L’archevêque de Séville, par exemple, est un mystique, alors que celui d’Oviedo est un Pidalin, un politique ». Il y a quelques mois, dans El Nacional de Buenos Aires (dans l’article lu par Fray Martínez Vigil) il avouait que pour lui la religion était la chose essentielle de la vie et que le catholicisme de l’Espagne ancienne était une des religions les plus respectables et des plus poétiques. Et c’est pour cela qu’il n’hésite pas à dénoncer ces prélats qui n’ont pas un atome de religion véritable. Pour lui, ce fanatisme des Espagnols du dix-neuvième siècle qui ne voient qu’abomination dans la vie moderne, qui veulent imposer leurs dogmes à coups de dents, n’ont rien de respectable, car la véritable religiosité est absente de leur âme. Cette stupide intolérance, cette haine pour leurs semblables qui ne pensent comme eux, cette dureté de tête et de cœur, sont incompatibles avec l’esprit évangélique et ces catholiques qui s’en tiennent au rite sont aussi éloignés de la foi de Jésus que ceux qui adoraient les cochons et les chevaux.
Ces propos sont, en effet difficilement acceptables pour un prélat comme Fray Martínez Vigil. Mais ce que celui-ci ne peut comprendre c’est que Alas est un authentique chrétien, qu’il est mu par un fort souci de pureté religieuse et que plus il se rapproche, au cours des ans, du catholicisme, plus il se montre intransigeant envers cette formidable organisation de l’Église espagnole qui, au lieu d’être une source de spiritualité, est un obstacle au spirituel et une entrave au progrès intellectuel et social de la nation. En peu de mots : « Cette Église qui veut imposer sa domination à tous les secteurs de la vie espagnole (la politique, l’enseignement, le presse, la culture), qui invoque le « Dieu des armées », qui prétend vassaliser les esprits et les cœurs par l’imposition d’une morale vide et de pure façade, a oublié la vie, le sang, la substance de la véritable religion ». Les exemples pourraient être multipliés. Le sens de sa constante lutte est donné par la citation suivante : « Plus on est religieux (et je ne crois pas rationnelle aucune manière de vivre qui ne soit profondément religieuse), plus est répugnant le spectacle offert par ces misérables positivistes pratiques et vulgaires qui se sont emparés de la coquille vide d’une grande institution historique ».
Apparemment aucune suite n’a été donnée à la sournoise démarche de l’évêque et il semble que cette missive et l’article d’Angelón qui l’accompagnait soient restés ensevelis dans les archives du Ministère. Si cela n’avait pas été le cas, il est probable que Clarín aurait vivement réagi et que ses relations ultérieures avec Fray Martínez Vigil ne se seraient certainement pas apaisées.
……………………………………………………………
Quelques mois plus tard, le 28 octobre 1892, arrive à son domicile, maintenant rue Campomanes, un paquet de la part de l’évêque d’Oviedo, contenant un livre et une lettre. Le livre s’intitule La Creación, la Redención y la Iglesia, ante la ciencia, la crítica y el racionalismo (Leopoldo ne manque pas d’observer la mise en valeur des mots Creación, Redención, Iglesia et le jeu significatif de la taille des caractères) et porte la dédicace : « Monsieur don Leopoldo Alas, Professeur de l’Université, comme preuve que son indigne prélat ne l’oublie pas ». Quant à la lettre, elle est ainsi tournée :
Mon cher Leopoldo :
Je vous remets le fruit —passons sur le mot— de mes nuits d’hiver, non parce que je pense qu’un livre, même s’il avait infiniment plus de valeur que le mien, pût guérir certaines maladies, mais pour vous montrer que votre ami cher qui vous baise la main vous recommande à Dieu et ne vous oublie pas.
Il est fortement surpris ! Comment est-il possible que Fray Ramón Martínez Vigil, ami et même complice du cacique Pidal, qu’il qualifiait il y a seulement quelques mois de Frère Falot et d’évêque d’Alejandrópolis, qu’il accusait publiquement dans Madrid Cómico d’inciter les journaux réactionnaires d’Oviedo à s’en prendre quotidiennement à sa personne, comment est-il possible qu’il l’appelle aujourd’hui « Mon cher Leopoldo » et apparemment sans la moindre ironie. Comment expliquer ce brusque revirement ? Remords de ne s’être pas bien comporté à son égard ? Après avoir lu certains de ses articles sérieux sur le sens religieux, la foi, le christianisme, les Évangiles, a-t-il enfin compris que ce professeur iconoclaste était un homme à la recherche d’une vraie religion du cœur et de l’esprit, bref, une âme authentiquement religieuse et qui plus est, profondément chrétienne ? Mais ce revirement est si insolite ! Et si cette main tendue était un calcul, un moyen de l’attirer à lui, de le neutraliser ? Eh bien, réflexion faite, il prendrait cette main en signe de reconnaissance de ce pas vers lui et s’il s’agissait d’un calcul, si la démarche n’était pas spontanée, ne venait pas directement du cœur, ce serait lui, l’évêque qui serait le perdant dans l’affaire. Il allait donc lui répondre comme le ferait un homme de bonne foi à qui on tend la main de la concorde.
Assis à sa table de travail, face à Victor Hugo, il répond à ce prélat qu’il veut voir sous un nouveau jour. « Très respectable et cher Monsieur : C’est avec une bien agréable surprise que je reçois le précieux cadeau de votre livre et l’affectueuse lettre qui l’accompagne et dont je ne mets pas en doute la sincérité ». En tant que critique, il promet d’étudier cet ouvrage qu’il a bien voulu lui dédicacer et à en parler dans « l’étude qu’il pense consacrer à la très sympathique œuvre entreprise par une grande partie du clergé moderne et qui consiste à traiter scientifiquement et dans un sens progressif, tolérant et conciliant, dans la mesure du possible, les problèmes les plus ardus en relation avec la doctrine de l’Église ». Avec cette missive, il lui envoie deux de ses livres et il lui recommande la lecture d’un de ses articles sur « La Unidad Católica, por Víctor Díaz Ordóñez », publié il n’y a pas si longtemps dans La España Moderna, où il pourra voir ses idées actuelles sur les sentiments que doit inspirer le catholicisme à tout bon Espagnol. Pour ce qui est de sa charitable allusion à la guérison, il ne nie pas qu’il puisse être malade, mais il est sûr qu’il ne s’agit pas d’un refroidissement. Comme il ne tire aucune vanité de se croire en bonne santé, ni de corps ni d’esprit, il est à la disposition de tous les médecins, intelligents et charitables, comme l’est celui qui vient au bon moment de faire un pas vers lui et il lui promet de faire en sorte qu’il ne soit pas perdu par sa faute. « De tout cœur, je vous réitère mes plus sincères remerciements et je vous prie d’excuser ma longue réponse à votre laconique et éloquente missive ».
Il pense souvent à Ramón Martínez Vigil qui, semble -t-il, lui a pardonné les nombreuses piques qu’il lui a lancées dans la presse. Il s’est moqué de lui en l’affublant du pseudonyme de Frère Falot, il l’a traité d’évêque politique, de fanatique, etc. et, apparemment, il n’a pas réagi. Il est certainement plus intelligent qu’il ne l’avait cru. Peut-être est-il bon pasteur, malgré ses relations avec Pidal et son exclusivisme catholique ; il semblerait qu’il soit apprécié de ses fidèles. Ses fidèles de Vetusta !
En tout cas, leurs relations sont cordiales, bien que très épisodiques. Parfois, ils se rencontrent, à l’occasion d’un mariage ou d’une manifestation publique et ils échangent quelques mots. Il a même osé lui demander plusieurs faveurs pour des prêtres de sa famille ou de ses connaissances : un vieux curé de campagne qui voudrait changer de paroisse, un de ses jeunes neveux fort méritant qui aspire à une place au Séminaire. Dans chaque cas, l’évêque a essayé de lui donner satisfaction Il paraît que dans les paroisses des campagnes, la rumeur court qu’il a une certaine influence, lui Clarín, sur l’évêque qui prend en compte les recommandations qu’il lui présente, ce qui n’est tout de même pas le cas.
Mais les échanges épistolaires imposés par ces recommandations permettent d’établir timidement une discussion sur des questions pour lui palpitantes. Le jour de Noël de 1893, il lui écrit pour lui adresser « ses plus cordiales félicitations pour sa pastorale La Voix du Pape », qu’il a lue d’un trait le matin même de sa réception. « Elle est en effet, la voix du Pape interprétée de manière magistrale sans animosité ni sarcasmes de vainqueur contre des partis politiques qui, il a quelque temps, représentaient une grande partie des ecclésiastiques espagnols. C’est une calomnie de voir la pastorale comme une bastonnade infligée aux carlistes (on ne donne pas de bastonnade avec la crosse), elle est, par contre, une très opportune, énergique et fort autorisée défense du grand sens chrétien et civilisateur de concorde et de relatif progrès qui inspire la politique sociale de l’admirable Léon XIII ». Lui, qui n’est plus catholique et qui le clame, voit en Léon XIII une promesse d’évolution de l’Église vers une tendance à la conciliation, vers certaine tolérance qui tranche avec l’abrupte position du Pie IX du Syllabus qui régit encore le catholicisme espagnol. Il se demande si son évêque, il a peu si intransigeant, est aussi enthousiaste que lui de voir cette évolution et de l’accompagner. Pour l’heure, le prélat en tire profit au bénéfice de son camp en affaiblissant les dissidences intégristes et carlistes.
Peu de temps après, il reçoit une lettre de l’évêque qui le remercie pour lui avoir offert deux livres de critique, Mezclilla, et Ensayos y Revistas et un livre de contes, El Señor y lo demás, son cuentos.
J’en avais déjà lu une bonne partie, car bien que totalement profane en littérature, je prends plaisir à la lecture d’une bonne prose et de la littérature d’agrément. Mais c’est un champ que je n’ai jamais pu cultiver par manque de temps.
Ainsi donc, l’évêque lit ses livres ? Pour le plaisir, comme il dit ? Pour capter ce qu’il pense, comme un censeur ? En tout cas, il a l’air de le suivre de près, à distance. Avec cet évêque, on ne sait pas vraiment à quoi s’en tenir.
La suite, qui revient sur le thème de sa lettre à propos de la pastorale La Voix du Pape, est pour lui une surprise, car elle confirme sa position face à Léon XIII et le fait apparaître presque libéral :
Vous dites fort justement que je n’ai pas voulu taper sur les carlistes, bien que pour certains bien malgré moi. Depuis Louis XIV, les doctrines de l’Église sur le pouvoir ont été oubliées. L’absolutisme a étouffé la liberté légitime et on a voulu transférer sur la personne des rois la notion de pouvoir divin […] De là la confusion.
Pour terminer, l’évêque le remercie de ce qu’il a écrit de sa pastorale, ce qui, dit-il, l’étonne fort, « car vos idées relèvent de la doctrine courante de la scolastique ». Ainsi donc, l’évêque est bien plus libéral qu’il ne pensait et lui, il manie les idées courantes de la scolastique. Curieux retournement. Il sourit.
Pourtant il apprend que l’évêque a envoyé en octobre 1892 au Ministre de Grâce et Justice une protestation contre la permission accordée à un Congrès de libres penseurs qui devait se tenir à Madrid, qu’en 1894 il a publié dans La Opinión de Asturias un article « Contre la liberté de culte », et que cette même année il a élevé une plainte auprès du Ministère de Grâce et Justice contre la permission accordée à l’ouverture d’une chapelle protestante. Double langage ? Qui est donc réellement Fray Ramón Martínez Vigil ?
Le 18 septembre 1896, sa mère, doña Leocadia, meurt subitement. Sa douleur est infinie. Les jours suivants il se sent perdu. Sa mère était très pieuse et sans trop savoir ce qu’il peut faire, il s’adresse à l’évêque pour lui demander une faveur, il ne sait laquelle exactement. Peut-être une indulgence pour recommander à Dieu l’âme de sa mère ?
La lettre de condoléance de l’évêque pour « la douloureuse disparition de ce modèle de mère chrétienne » est accompagnée des documents à compléter pour la demande des indulgences et le jour même de la réception de la missive, il répond à l’Excellentissime et Illustrissime Evêque d’Oviedo : « Très respectable et estimé ami : Je vous remercie de toute mon âme pour cette faveur des indulgences et pour vos paroles de sympathie […] J’aurai bientôt l’honneur de venir vous saluer à l’Evêché pour vous manifester ma reconnaissance ».
……………………………………………………………
Les relations apaisées, cordiales et presque amicales établies au cours des années entre Leopoldo Alas et l’évêque d’Oviedo n’effacent pas les traces de la polémique de 1885, gravées dans l’humus épais du conservatisme catholique (qui sous le franquisme deviendra le national-catholicisme). Les réactions plus ou moins ironiques de la presse libérale, républicaine et anticléricale et surtout la reproduction de la cinglante lettre de Leopoldo Alas, qui résonne comme un coup de clairon (Clarín) ne font que renforcer un sentiment d’humiliation à la suite d’une sorte d’attaque de lèse-majesté cléricale et à partir de ce moment La Regenta et son auteur sont mis à l’index des œuvres et des personnes dangereuses.
Pour le secteur catholique conservateur, plus ou moins dominant en Espagne à la fin du XIXe siècle et au du début du XXe, La Regenta sera définitivement marquée par le jugement idéologique de l’évêque d’Oviedo, cette sorte d’anathème qui réunit tous les thèmes de répulsion morale et intellectuelle d’un catholicisme intransigeant, voire intégriste : Athéisme, corruption, érotisme, dérision des pratiques chrétiennes, allusions injurieuses à des personnes dignes de respect.
Quant à l’auteur, il sera considéré comme un brutal agresseur de l’honneur d’honnêtes gens, un ennemi. Clarín n’est-il pas un républicain proclamé qui a toujours attaqué l’institution catholique pour son manque de spiritualité et n’a jamais hésité tout au long de sa carrière de journaliste et d’écrivain à dénoncer prêtres, évêques et archevêques lorsque ceux-ci se portaient plus comme des politiques ou des fonctionnaires, parfois corrompus, que comme de bons pasteurs ? En plus, cet énergumène est l’auteur d’un roman sulfureux. Pour se préserver de l’un et de l’autre, le plus sûr moyen est l’oubli. Cette guerrière volonté d’oubli des « bien-pensants » est favorisée par l’évolution des goûts et des orientations littéraires ; le grand réalisme espagnol (qui a assimilé le meilleur du naturalisme) de la deuxième moitié de XIXe siècle et dont La Regenta est un des meilleurs fruits, est substitué par d’autres tendances dominantes, le modernisme, la brillante génération poétique de 27, etc.
La Regenta est vraiment oubliée pendant plus d’un siècle et n’accède en plénitude au canon d’œuvre mémorable, de classique contemporain, que dans les années 1980. Avant cette date, les seuls écrits qui ont subsisté sont quelques recueils d’articles de critique littéraire réunis par l’auteur et quelques contes devenus populaires. Leopoldo Alas a publié plusieurs livres de contes, dont certains ont eu un grand succès et l’ont toujours, car selon Gonzalo Sobejano, le plus fin connaisseur de son œuvre, Leopoldo Alas est le fondateur du conte moderne
Leopoldo Alas est mort en 1901, à quarante-neuf ans, sans savoir qu’il était l’auteur d’un chef-d’œuvre pouvant rivaliser avec Madame Bovary et Anna Karénine. Outre la haine des bien-pensants réactionnaires et des ultra-catholiques qui ont enfoncé dans l’oubli ce roman « néfaste », ses contemporains libéraux, même les plus ouverts, n’ont pas compris que La Regenta était le chef-d’œuvre du grand réalisme du XIXe siècle. Pour la plupart, ce roman était trop complexe et trop chargé en « luxure ». Même son ami Galdós, dont il a été le constant et enthousiaste panégyriste et l’actif artisan médiatique de son succès immédiat, a tardé des années à terminer le prologue promis pour la deuxième édition de La Regenta qui n’a vu le jour que quelques mois avant que ne s’éteigne la dernière lueur de la conscience de son auteur.
A partir des années 1980, ce roman ainsi consacré est traduit en une dizaine de langues. En France, La Régente, publiée par les Éditions Arthème Fayard en 1987 a connu un grand succès (plus de quinze mille exemplaires vendus en quelques années) après une campagne de presse particulièrement bien orchestrée et efficace, bien qu’elle n’ait pu éviter le débordement des lieux communs, plus ou moins condescendants mis en exergue par les titres mêmes de certains articles (La protagoniste, Ana Ozores, qualifiée de « La Emma Bovary des Asturies », et l’auteur présenté comme « Le Flaubert des alcazars » —sic—). Il y eut aussi de nombreux articles très pertinents ; celui de Pierre Lepape dans Le Monde des Livres (11 septembre 1987), intitulé : « Un immense roman de la vie intérieure » mérite d’être cité. Et, consécration suprême, un brillant passage dans l’émission Apostrophes de Bernard Pivot en présence de Mario Vargas Llosa et de Georges Semprun. Bref, plus de cent ans après la pastorale de l’évêque d’Oviedo, un immense succès. Enfin, consécration universitaire, en France, le roman La Regenta a été mis au programme des concours de recrutement des enseignants d’espagnol dès 1968 et, en 1991, pour deux années consécutives. Par contre, son deuxième roman, Su único hijo, traduit en français, Son fils unique, et édité aussi par Fayard en 1990, privé du support médiatique qui avait porté La Régente, est passé inaperçu.
Quant aux contes, genre où, on l’a dit, Leopoldo Alas excelle, un échantillon de son talent en ce domaine est donné, en France, dans l’édition bilingue de l’anthologie intitulée Le coq de Socrate, publiée en 1992, par les Éditions José Corti.
Après sa mort, en 1901, Leopoldo Alas, dit Clarín a été vite enseveli sous la poussière d’un temps dans lequel s’était enkystée la haine invétérée semée par l’anathème de Monseigneur Fray Martínez Vigil. Il n’a refait brièvement surface qu’à la suite du dramatique craquement historique qu’a été la guerre civile. Quand, en 1937, les hordes fascistes de Franco ont envahi Oviedo, la haine de Vetusta et de l’Espagne réactionnaire contre Clarín et son œuvre a sorti ses griffes : le fil aîné Leopoldo, Polín, recteur très apprécié de l’Université d’Oviedo, a été « légalement » fusillé après un simulacre de procès : il était clair pour beaucoup de gens y compris pour le supplicié qu’il s’agissait de tuer le père en assassinant le fils. Malgré les appels à la clémence venus de l’intérieur, malgré les nombreuses et pressantes manifestations internationales, le général Franco, incarnation de la haine nationale-catholique, est resté insensible et a couvert le crime d’Oviedo, comme celui de García Lorca à Grenade, comme des milliers et des milliers d’autres. Et l’Espagne a dû supporter pendant quatre décennies la chape de plomb de la dictature du général Franco. C’est seulement en 1975, à la mort de cette anomalie historique, que l’Espagne a pu se libérer de cette féroce haine acéphale dressée contre tout ce qui n’était pas l’ordre franquiste. Alors, après cette date, la personnalité riche et forte de Leopoldo Alas, dit Clarín, a pu être reconstruite grâce à la publication de toutes ses œuvres et à l’exhumation, des hémérothèques de Madrid et d’autre villes d’Espagne et d’Amérique Latine de son abondante production journalistique qui occupe six gros volumes, sur les douze des Obras completas de Leopoldo Alas, Clarín, éditées par Nobel (Oviedo, 2002-2006) et son œuvre majeure La Regenta, être brusquement considérée comme un classique contemporain universellement reconnu.
Le titre des pages qui précèdent « Leopoldo Alas Clarín, La Régente et l’évêque » marque, on le voit, le début de l’histoire d’une haine tenace, une de ces haines historiques au long cours, dont on n’est jamais assuré d’être définitivement libéré, même dans nos nations de civilisations soi-disant avancées.
Nota bene
Dans ce texte tout est avéré et pourrait être référencé, mais l’introduction d’une bibliographie complète serait un lourd obstacle à la lecture fluide de la narration.
Voici les sources fondamentales du récit :
- Alas Clarín, Leopoldo, Obras Completas, Oviedo, Ediciones Nobel, 2002-2009, tomes V, VI, VII, VIII, IX, X (Artículos) et XII (Epistolario), édités par Jean-François Botrel et Yvan Lissorgues.
- Labra, Ricardo, El caso Clarín. La memoria y el canon literario. Epílogo 1: Jean-François Botrel: «Ironía y poder de la Historia». Epílogo 2: Leopoldo Tolivar Alas, «¿Caso particular o causa general contra una ciudad?», Oviedo, Luna de Abajo, 2021.
- Lissorgues, Yvan, « Introduction » à La Régente, Paris, Fayard, 1987, pp. 7-32.
- Lissorgues, Yvan, Leopoldo Alas, Clarín, en sus palabras (1852-1901), Biografía, Oviedo, Editorial Nobel, 2007.
- Martínez Cachero, José-María, Las palabras y los días de Leopoldo Alas, “Clarín” (Miscelánea de estudios sobre “Clarín” ), Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1984.
[1] Approchant de la puberté, âge qui, en Droit romain, donnait au pupille le droit de tester.
[2] Leopoldo Alas se réfère ici à l’étymologie d’episcopus d’où provient le terme obispo (évêque en espagnol), soit epi (sur) et scopus (examiner), l’archiepiscopus ayant donc une capacité supérieure—ou excessive— à exercer la surveillance.
[3] « Y aquí, para entre los dos, si hallo harto paño en efeto, con muchísimo respeto os he de ahorcar, juro a Dios” Et, soit dit entre nous, si je trouve matière suffisante pour cela, en effet, avec le plus grand respect, sur ma foi, je vous pendrai”, réplique l’alcade villageois de Zalamea au capitaine qu’il a fait arrêter pour avoir violé sa fille et refusé la réparation, entraînant cette réflexion du capitaine : « Ah ! Quand les cul-terreux ont du pouvoir ! », dans El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (1651).
[4] Dans son Arte de hablar en prosa y verso (1826), un manuel de rhétorique encore en vigueur du temps du jeune Leopoldo Alas, José Mamerto Gómez Hermosilla (1771-1837), distingue en fait (tome I, pp. 162-169) sept espèces d’ironie : l’antiphrase, l’asthéisme, le charientisme, le chleuasme, le dyarsime, le sarcasme et la mimèse qui consiste à affirmer ce que l’on nie
[5] De quel procédé Leopoldo Alas feint-il d’avoir oublié le nom ? On peut hésiter entre le chleuasme et le charientisme.
[6] Gil Blas et El Solfeo sont deux journaux satiriques madrilènes auxquels Leopoldo Alas collabora —avec assiduité s’agissant du second— entre 1868 et 1877.
[7] Dans Il Barbiere di Siviglia de Rossini et Sterbini, d’après Beaumarchais, Acte I, Scène 8 : "La calunnia è un venticello".